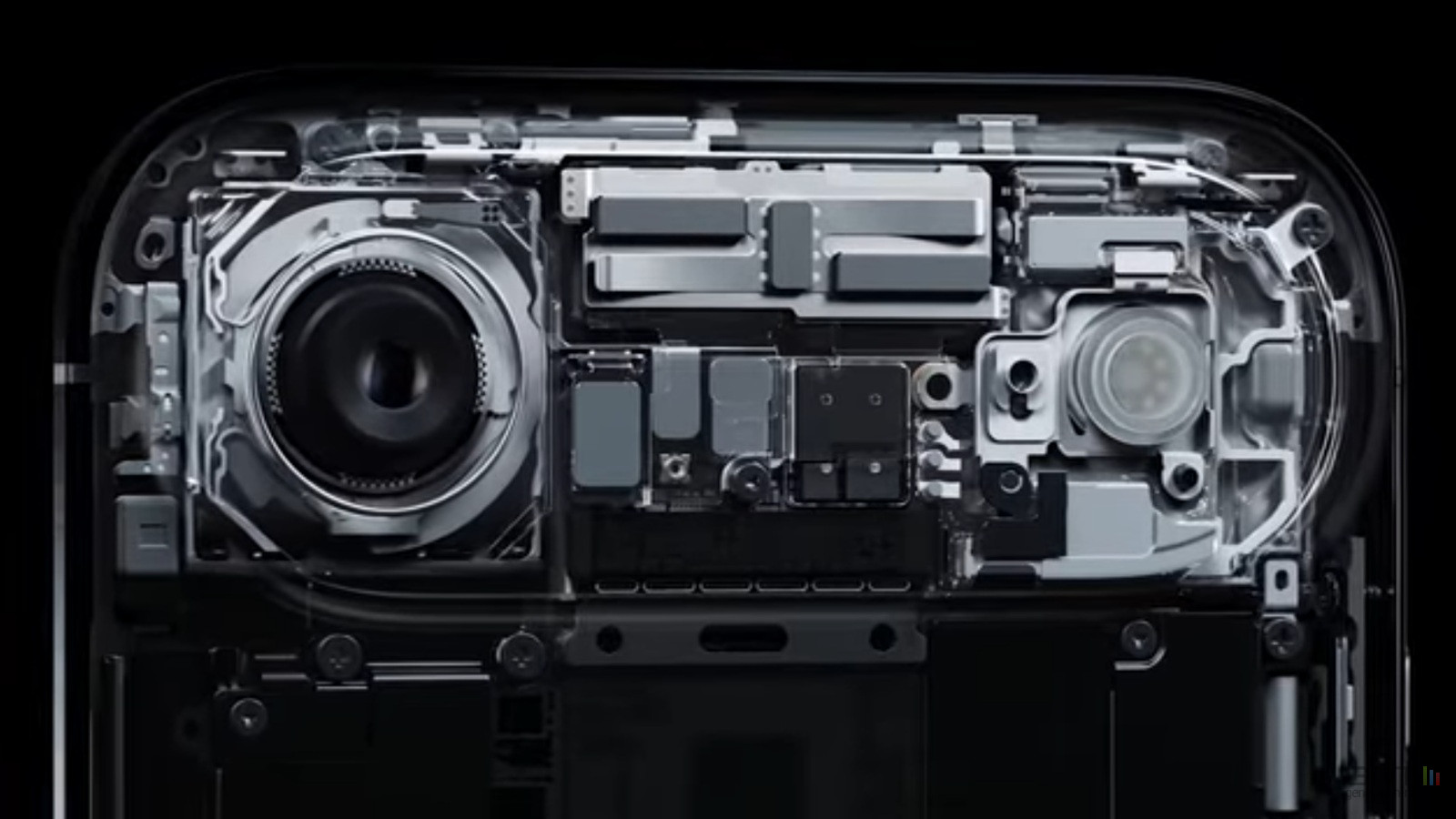Related News
Marche verte : 50 ans d’histoire, de stratégie et de leçons diplomatiques - Part 1-
Posted by - Senbookpro KAAYXOL -
on - 2 hours ago -
Filed in - Society -
-
7 Views - 0 Comments - 0 Likes - 0 Reviews

En 1975, la Marche verte a marqué un tournant décisif dans l’histoire du Maroc et du Maghreb. Mais pour comprendre la portée de cet événement, il faut revenir sur la perception du royaume à l’époque : un État ancien, centralisé, respecté, mais aussi isolé dans un environnement dominé par les régimes militaires et socialistes. Retour sur le contexte de la Marche Verte avec le politologue Driss Kassouri.
Dans cette première partie (1/3), notre interlocuteur revient sur l’image et la perception du Maroc par ses voisins, aussi bien internationaux que régionaux, et sur la naissance de l’affaire du Sahara.
1975, le Maroc face à ses voisins : puissance unie ou royaume sous pression ?
Pour Driss Kassouri, comprendre les enjeux de 1975 s’inscrit dans la continuité d’une phase plus ancienne. « La question du Sahara n’est pas née dans les années 1970, elle remonte à la période coloniale. C’est le colonialisme, notamment français, qui a morcelé le territoire marocain, en amputant des terres au sud, à l’est et à l’ouest, dans le but d’affaiblir le Maroc, qui était historiquement une grande puissance impériale », a-t-il indiqué.
« Le Maroc, à travers l’histoire, a toujours été une nation forte, indépendante et respectée, souvent victorieuse dans ses affrontements avec les puissances occidentales. C’est le Maroc qui est allé en Andalousie, qui est arrivé jusqu’au Sénégal, et qui a arrêté l’avancée européenne vers l’Afrique lors de la bataille de Zallaqa, dite des Trois Rois. C’était un pays ancien, structuré et politiquement organisé, aussi bien au niveau du pouvoir du sultan que de celui du Makhzen (l’administration d’État) », a indiqué l’expert.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, possédait déjà une forme de gouvernance centralisée, avec des ministères, des conseils consultatifs, des caïds, des pachas, des notables, des juges et des élites, et une méthode claire dans la prise de décision et la gestion du pouvoir. À l’époque, peu de pays arabes ou africains avaient cette profondeur historique et institutionnelle, à part l’Égypte. La majorité vivait selon des structures tribales, ethniques ou sujettes à des guerres et des coups d’État, sans autorité centrale stable.
Pour sa part, le Maroc a su traverser les siècles à travers les différentes dynasties (Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens, puis Alaouites) en conservant une gouvernance établie, une armée nationale et des institutions fonctionnelles, même si les moyens étaient limités.
« C’est pour cela que l’Occident a toujours perçu le Maroc comme un royaume fort, uni, souverain et stratégiquement important. Cette image a conduit les puissances coloniales à démembrer son territoire afin de le contrôler et de réduire son influence », a indiqué Kassouri, soulignant que le Maroc disposait aussi d’une habileté diplomatique reconnue, entretenant des relations politiques avec des puissances comme la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne et les États-Unis.
Le Maroc fut d’ailleurs le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis, preuve qu’il n’était pas une petite nation inconnue, mais une voix forte et respectée sur la scène mondiale. À travers ses ambassadeurs, le Maroc occupait déjà une place diplomatique importante depuis des siècles.
Mais cette même image de puissance a poussé l’Occident à vouloir diviser et affaiblir le Maroc, en créant des zones de conflit et de tension internes destinées à le maintenir sous pression et sous chantage, a déclaré le politologue, avant d’ajouter que durant la colonisation, cette stratégie s’est accentuée.
« Le Maroc a soutenu activement la lutte de libération de l’Algérie, aussi bien matériellement que politiquement. Cet engagement a coûté cher au Maroc, entraînant même des défaites militaires et facilitant, par ricochet, l’entrée des puissances étrangères », a-t-il noté.
Après l’indépendance, le roi Mohammed V avait un objectif clair, à savoir corriger les erreurs du passé et récupérer les terres marocaines. « Il disait à Abderrahim Bouabid qu’il saurait comment rendre au Maroc ses droits et réparer les torts hérités du colonialisme. » « C’est ce qui s’est fait, progressivement, à travers les années de lutte jusqu’à l’indépendance dans les années 1950, puis à travers une politique d’unité territoriale menée avec patience et stratégie ».
Le Maroc a ainsi choisi une voie pacifique et graduelle, préférant négocier la sortie de la France sans internationaliser les questions de frontières, surtout avec l’Algérie. L’idée du Maroc était de construire une unité régionale maghrébine, car son indépendance ne serait complète que si ses voisins l’étaient aussi.
Le Maroc a d’ailleurs été à l’origine de la première alliance pour l’indépendance du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte), lors d’une conférence tenue à Casablanca. Kassouri a indiqué que le Maroc a toujours cru en une vision unitaire nord-africaine et africaine, basée sur la solidarité et l’indépendance collective.
« Mais après l’indépendance de l’Algérie, la France a proposé de tracer les frontières du sud avant de partir. Le Maroc, animé par une volonté de fraternité et de bonne foi, a refusé, préférant discuter directement avec l’Algérie une fois celle-ci indépendante », a-t-il déclaré.
« C’était la vision sincère et humaniste de Mohammed V, qui croyait à l’unité du Maghreb et à la profondeur africaine du Maroc. Malheureusement, cette bonne intention sera mise à mal à la fin des années 1960, avec l’apparition de régimes militaires et nationalistes dans plusieurs pays arabes : Égypte, Irak, Libye, Algérie… », souligne le spécialiste.
Et d’ajouter que ces régimes, inspirés par des idéologies socialistes, panarabes ou communistes, se sont opposés au monarchisme du Maroc, le qualifiant de « conservateur » ou « réactionnaire ».
« Ils se sont ainsi ligués contre lui, encouragés par des puissances du bloc soviétique, tandis que le Maroc restait aligné sur le bloc occidental. L’Algérie, soutenue par la Libye et l’Égypte de Nasser, a commencé à abriter et financer le Polisario, dans le but de déstabiliser le Maroc et d’empêcher son développement », a déclaré Kassouri, soulignant que c’était aussi une période de guerre froide, où le monde était divisé en deux blocs rivaux.
Le Maroc, sortant tout juste du colonialisme, devait en même temps faire face à des problèmes internes, notamment les tentatives de coup d’État militaires des années 1970, les crises sociales (comme les émeutes de 1965), ou encore les tensions politiques avec la gauche marocaine, les fameuses « années de plomb ».
*« Malgré cela, le roi Hassan II a fait preuve d’une grande intelligence politique. Il a lancé en 1975 la Marche Verte, en coordination avec l’Espagne et les États-Unis, pour récupérer pacifiquement le Sahara marocain. Cette marche populaire fut un succès diplomatique et stratégique, réaffirmant la souveraineté du Maroc »*, a-t-il précisé.
Mais selon lui, cela a enflammé la réaction du Polisario, soutenu par l’Algérie et la Libye, provoquant des affrontements comme la bataille d’Amgala (1976), où l’armée marocaine a remporté une victoire importante. « Le roi Hassan II, malgré cette supériorité, a choisi de ne pas envahir l’Algérie, privilégiant la stabilité et le dialogue », a rappelé le politologue.
Face à la guerre du Sahara et aux tensions internes, le Maroc a adopté « une stratégie de patience », préférant une lutte diplomatique longue à une confrontation militaire coûteuse. Il a attendu un changement du contexte international, notamment la fin de la guerre froide et la chute du bloc soviétique, pour renforcer sa position, a ajouté Kassouri.
Et depuis, dans les années 1990, après le cessez-le-feu, le Maroc, sous la direction du roi Hassan II, a pu se recentrer sur sa consolidation interne, préparer la transition royale et redéfinir sa place sur la scène internationale. « C’est cette stratégie à long terme, mêlant diplomatie, stabilité et développement interne, qui a permis au Maroc d’obtenir la reconnaissance internationale de ses positions actuelles », a estimé le politologue.
The post Marche verte : 50 ans d’histoire, de stratégie et de leçons diplomatiques - Part 1- appeared first on Hespress Français - Actualités du Maroc.