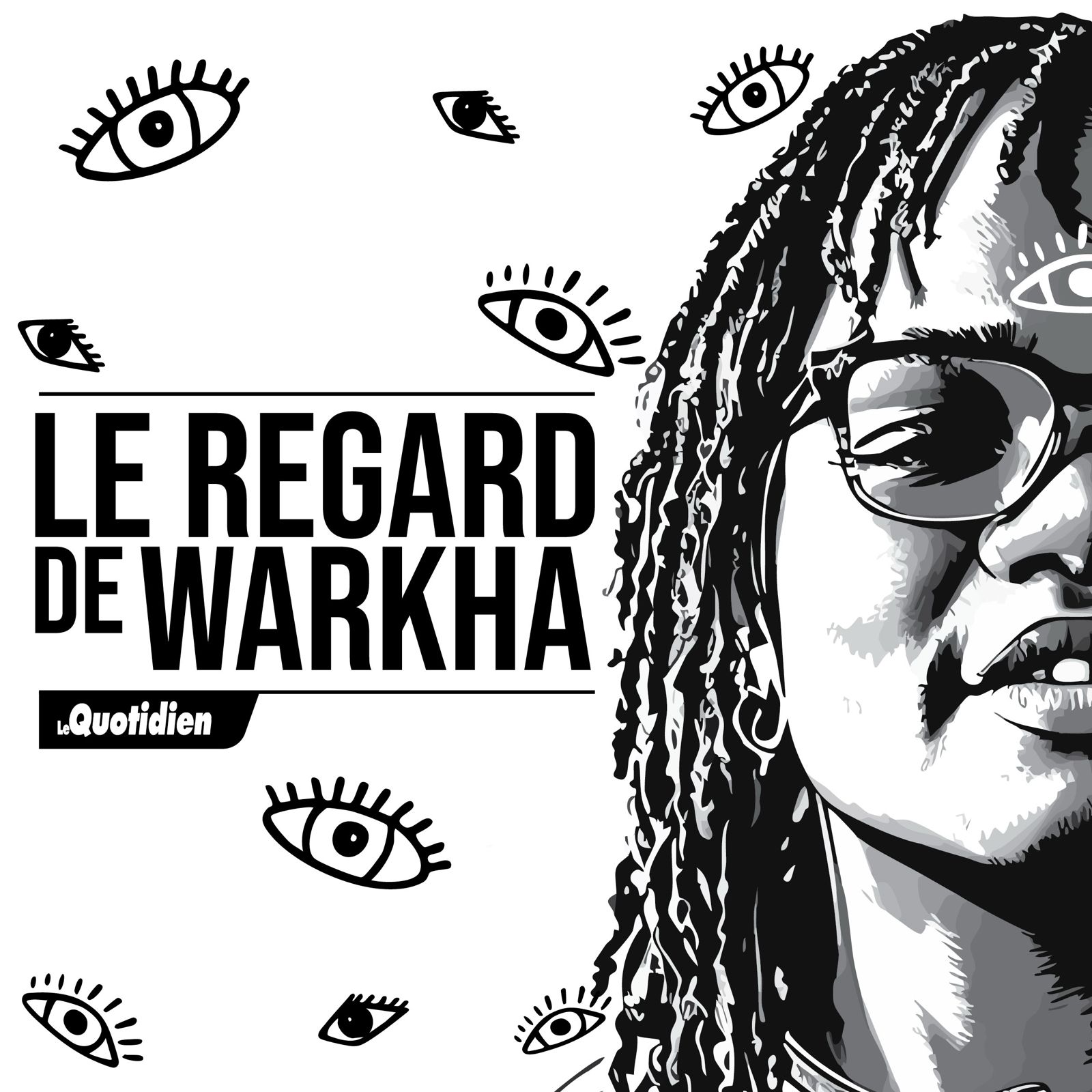Vous m’avez manqué, chères lectrices et chers lecteurs. Cette absence est due à la sortie de mon premier livre, Assignée au silence, publié chez L’Harmattan Sénégal, un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Pour les besoins de sa préparation et de sa publication, j’avais choisi de me retirer un temps. Mais pendant ces semaines, tant d’actualités m’ont traversée, tant de choses m’ont brûlé les lèvres. Parmi les mille et une, il en est une que je ne pouvais pas taire : le projet du Conseil municipal de Dakar Plateau de rebaptiser plusieurs rues de la capitale.
Cette liste, composée exclusivement de noms d’hommes, m’a littéralement volé le sommeil plusieurs nuits durant. Comment, en 2025, peut-on encore redessiner la carte d’une capitale sans y inscrire le nom de celles qui ont porté, soigné, enseigné, résisté et transmis ? Cette invisibilisation renouvelée n’est pas anodine. Elle traduit la persistance d’une société où la gloire et la reconnaissance restent des privilèges masculins. Ce qui m’a hantée, c’est cette répétition d’une substitution qui ne change rien au fond. Les nouveaux noms remplacent d’anciens noms d’hommes certes, mais toujours d’hommes, cette fois africains. En voulant effacer l’empreinte coloniale, on aurait pu aller plus loin, dépasser le simple échange de plaques entre dominants pour faire place à celles qui ont été doublement oubliées. Enlever les noms des hommes blancs pour y mettre ceux des hommes noirs ne suffit pas ; il faut aussi y inscrire ceux des femmes. Car se départir de l’héritage colonial, ce n’est pas seulement changer de figures masculines, c’est enfin reconnaître la moitié du Peuple restée sans nom, sans rue, sans trace.
Lorsque j’ai vu la liste, je me suis tout de même demandé : mais où étaient les femmes dans ce conseil ? Quelle a été leur réaction face à une telle proposition ? Moi aussi, j’ai vécu un épisode similaire au sein du Conseil municipal de Pikine Nord, où je siège comme conseillère. A l’approche de la rentrée des classes, le maire avait proposé de donner deux noms d’hommes à de nouveaux établissements scolaires de la commune. Je m’y suis opposée, plaidant pour qu’on pense aussi aux femmes de notre commune. Malgré les applaudissements, la proposition est passée : le maire avait la majorité des voix. J’imagine que c’est ce qui s’est produit à Dakar Plateau. Quelques rares voix ont peut être tenté de s’opposer à cette liste d’hommes. Du moins, c’est ce que je veux croire, car il m’est impossible d’admettre que personne n’ait remarqué qu’aucun nom de femme n’y figurait. Non, je ne peux pas y croire.
En remplaçant des noms d’hommes blancs par ceux d’hommes noirs, le pouvoir municipal a poursuivi la même logique d’exclusion, celle qui considère la mémoire collective comme un espace masculin. Présenté comme un devoir de mémoire, ce projet aurait pu être un acte de réappropriation véritable : non seulement effacer l’empreinte coloniale, mais aussi inscrire les femmes dans la carte, réhabiliter leurs trajectoires, leurs luttes et leurs héritages. En choisissant de rester dans la continuité, la mairie a manqué l’occasion de transformer ce geste symbolique en un acte de justice et de rééquilibrage historique.
Dans un communiqué publié le 8 octobre 2025, le Cadre de concertation pour le respect et la préservation des droits des femmes Ci la ñu bokk a exprimé son indignation. Leur texte est d’une justesse implacable : cet effacement n’est pas anodin. Il perpétue «un déséquilibre historique et invisibilise les contributions essentielles des femmes à la construction du Sénégal». Reconnaître la place des femmes dans la toponymie n’est pas un luxe, mais un acte de justice, de mémoire et d’équité démocratique.
Nommer, c’est reconnaître. Ne pas nommer, c’est effacer. La toponymie n’est pas qu’un détail administratif ; elle est un acte politique. Elle dit qui compte, qui inspire, qui appartient à la mémoire nationale. Et lorsque toutes les rues portent des noms d’hommes, c’est tout un pan de l’histoire qui disparaît. Les héroïnes sénégalaises, elles aussi, ont façonné ce pays : de Ndaté Yalla à Annette Mbaye d’Erneville, de Aline Sitoé Diatta à Mariama Bâ. Pourtant, leurs noms ne s’affichent sur aucune plaque bleue.
La mairie promet une «deuxième phase» de nominations plus inclusives. Mais faut-il vraiment attendre une deuxième chance pour reconnaître la moitié de la population ? Chaque rue rebaptisée sans nom de femme est une occasion manquée, un pavé de plus sur la route de l’invisibilité.
Face à ce scandale symbolique, la mobilisation s’est organisée. La plateforme des femmes Cilañubokk a lancé une campagne remarquable : toute la semaine, des militantes ont mis en lumière des femmes sénégalaises qui ont marqué l’histoire, la culture, la science, la justice et la vie publique. Objectif : rendre visibles celles dont les noms et les luttes méritent d’être inscrits dans nos rues, nos infrastructures, nos mémoires et nos histoires.
Cette campagne a mis en avant une liste impressionnante de figures féminines : Dior Fall Sow, première femme procureure de la République ; Rose Dieng Kuntz, pionnière de l’Intelligence artificielle ; Suzanne Diop Vertu, première magistrate du Sénégal ; Aminata Diaw Cissé, philosophe et universitaire ; Mame Madior Boye, première femme Première ministre… et tant d’autres. Autant de femmes qui ont marqué notre histoire mais dont les noms n’ornent toujours pas nos avenues.
Je pense aussi à la dame Waranga, à qui, par la force des choses, on a donné son nom au marché de Waranga, en reconnaissance de sa bravoure et de son utilité dans sa commune. Je pense à toutes ces femmes des marchés, des restaurants, des salons de coiffure, du commerce de rue, celles du secteur informel, invisibles et pourtant indispensables. Ces femmes aussi méritent que leurs noms soient gravés dans la mémoire collective, pour pérenniser leur histoire et marquer leur passage sur cette terre.
Cet effacement n’est pas une simple maladresse : il est profondément politique. Il traduit une structure de pouvoir où la visibilité reste un privilège masculin. En refusant de nommer les femmes, le pouvoir municipal réaffirme subtilement la hiérarchie du genre dans la sphère publique.
Les institutions locales et les partis politiques demeurent traversés par une culture patriarcale qui relègue les femmes à la périphérie des décisions. Le rebaptême des rues en est le symptôme : derrière les grands discours sur l’inclusion, se cache une réalité persistante : celle d’une société qui peine à céder la place. En refusant de donner aux femmes leur place dans la mémoire urbaine, on leur dénie symboliquement le droit d’appartenir pleinement à la cité.
Dans une démocratie, effacer les femmes de l’espace public revient à affirmer que leur rôle est secondaire. C’est une forme de violence institutionnelle, une négation du passé et du présent féminins. Une société qui se veut égalitaire ne peut continuer à cartographier son territoire en oubliant la moitié de son Peuple.
Il ne s’agit pas de repeindre l’histoire à la hâte, mais de la raconter dans toute sa pluralité. L’espace public n’est jamais neutre : il façonne les imaginaires, il éduque, il transmet. Tant que les jeunes filles marcheront dans des rues où aucun nom ne leur ressemble, elles apprendront sans le vouloir que la gloire a un genre. Il est temps d’ouvrir les cartes, d’écrire nos noms, d’ancrer nos récits.
Chaque rue porte un nom. Chaque nom porte un récit. Et tant que les femmes ne seront pas nommées, leur histoire restera sans adresse.
Par Fatou Warkha SAMBE
L’article Quand la ville s’écrit au masculin est apparu en premier sur Lequotidien - Journal d'information Générale.
 Everywhere
Everywhere Albums
Albums ITEM_TYPE_ALBUM_CATEGORY
ITEM_TYPE_ALBUM_CATEGORY ITEM_TYPE_SESNEWS_RSS
ITEM_TYPE_SESNEWS_RSS Members
Members Videos
Videos News
News