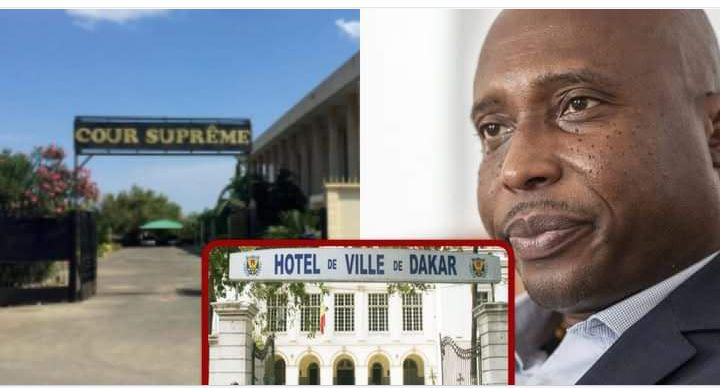Alors que l’Assemblée nationale entame, ce lundi 25 août, les travaux d’examen en plénière des quatre projets de loi sur la transparence et la lutte contre la corruption, Maurice Soudieck Dione, professeur agrégé de science politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous livre son diagnostic. Dans cet entretien accordé à Sud Quotidien, l’enseignant-chercheur, tout en saluant « des innovations démocratiques notables » introduites par ces nouvelles lois, met en garde contre certaines imprécisions et lacunes qui pourraient, selon lui, en affaiblir la portée et ouvrir la voie à des dérives
Les députés entament ce jour, l’examen en plénière des quatre projets de loi soumis à l’Assemblée nationale relativement à la transparence. Comment appréciez-vous globalement ces textes ?
Les quatre projets de loi soumis à l’Assemblée nationale relativement à la transparence : ré-institution de l’OFNAC (Office national de lutte contre la corruption) ; statut et protection des lanceurs d’alerte ; accès à l’information ; déclaration de patrimoine, constituent des avancées démocratiques à saluer mais qui nécessitent d’apporter certaines observations.
Venons-en à la loi sur les lanceurs d’alerte. Où se situent, selon vous, ces observations ?
Concernant la loi sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte, il faut dire qu’il y a plusieurs problèmes dans la définition même de la notion. En effet, aux termes de l’article 1 : « Le lanceur d’alerte est une personne physique qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, signale, communique ou divulgue de bonne foi des informations relatives à la commission ou à la tentative de commission d’actes portant sur un crime ou un délit financier, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation de violation affectant la gestion des finances tant dans le secteur public que privé. »
En quoi cette définition pose problèmes ?
D’abord sur la vulgarisation des informations. La formulation de l’article 1 est vague. “À qui le lanceur d’alerte signale-t-il, communique-t-il ou divulgue-t-il les informations ? À son épouse, à des collègues, à sa hiérarchie, aux associations de la société civile, à l’organe anti-corruption, à l’opinion publique par voie médiatique ?
La précision devrait être faite à ce niveau déjà dans la définition du lanceur d’alerte que les informations sont divulguées au référent de son administration, à l’organe anti-corruption ou à l’opinion publique dans les conditions prévues par la présente loi. Pour ensuite apporter les précisions au chapitre 2 intitulé : Procédures de signalement ou de divulgation.
En plus, si l’alerte est diffusée dans les médias et qu’elle se révèle par la suite fausse. Le coup est déjà parti et le mal est fait. C’est une calomnie. Que fait-on alors de la présomption d’innocence ? De la dignité du mis en cause jeté en pâture ? Le lanceur d’alerte est certes protégé mais les victimes d’un soi-disant lanceur d’alerte mal intentionné ont également le droit de le poursuivre en justice. L’article 1 affirme que le lanceur d’alerte divulgue des informations de bonne foi. Il faut savoir ce que recouvre la notion de bonne foi. Qui l’apprécie ? Sur quelle base ? Quels en sont les critères ? Tout cela doit être spécifié pour éviter un climat de suspicion, de délation, et même des risques de politisation des positions occupées dans l’administration ou des règlements de comptes entre clans opposés dans une même administration.
Quelle est votre avis sur les mesures de compensation ou de rémunération prévues dans ce projet de loi sur les lanceurs d’alerte ?
Le but de la loi sur les lanceurs d’alerte, c’est de moraliser la vie publique et de lutter contre la corruption. Or la loi prévoit justement que le « prête-nom » soit rémunéré lorsqu’il dénonce son complice, même si la loi utilise le terme « compensation » par euphémisme ; ce qui cache mal cette incongruité consistant pour le prête-nom à tirer son épingle du jeu si facilement. En effet, l’article 3 alinéa 2 du projet de loi sur les lanceurs d’alerte dispose : « Lorsque la personne concernée révèle, auprès de l’organe anti-corruption, les biens, fonds ou avoirs illicites dont elle est le « prête-nom », celle-ci est exonérée de la responsabilité pénale encourue et reste éligible à une compensation financière suivant les modalités prévues à l’article 20 de la présente loi. ».
L’article 20 dispose en ce sens : « La récompense susvisée est fixée à hauteur de dix pourcent (10%) du montant recouvré ou du montant déterminé par l’organe anti-corruption. » Même si les poursuites sont abandonnées pour le prête-nom après qu’il a dénoncé son complice, il ne doit pas être rémunéré. La dénonciation doit être désintéressée.
Que retenir du projet de loi sur la déclaration de patrimoine ?
Concernant le projet de loi sur la déclaration de patrimoine, on passe d’un critère financier d’assujettissement d’un milliard cinq cent millions à 500 millions, avec une extension aux chefs de cours, de tribunaux et de parquets, aux doyens des juges d’instruction et présidents de chambres, aux membres des corps et organes civils, militaires et paramilitaires de contrôle, d’inspection, de vérification, d’audit, d’enquête et d’investigation, et à tous les directeurs et chefs de service intervenant dans le secteur des mines, des carrières et des hydrocarbures. La déclaration de patrimoine est un instrument de lutte contre la corruption, l’enrichissement illicite et les pratiques de recels de biens, prête-noms, et situations de conflits d’intérêts. La déclaration de patrimoine doit être effectuée trois mois après la nomination ou l’élection et trois mois après la cessation des fonctions pour cause autre que le décès. Le projet prévoit également des sanctions pécuniaires, administratives et pénales en cas d’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine, de fausse déclaration, de déclaration incomplète, d’omission délibérée, de tentative d’altération ou de modification de son contenu, sur la base des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18.
Quel est votre avis, sur les critiques de certains observateurs qui dénoncent l’absence des dispositions prévoyant une déclaration de patrimoine à la fin du mandat du président de la République ?
La déclaration de patrimoine du président de la République est prévue par l’article 37 de la Constitution. Mais cette disposition ne prévoit pas une déclaration à la fin du mandat. Ce qui nécessite une réforme du texte.
Quelle est votre lecture sur le projet sur l’accès à l’information considéré comme une avancée majeure ?
Concernant le projet de loi sur l’accès à l’information, il faut dire que c’est un texte crucial d’autant plus que nous sommes dans un monde profondément ancré dans l’ère de l’information et de la communication. Le projet de loi délimite bien le cadre et les modalités d’accès à l’information, en établissant clairement la différence entre les informations couvertes par le secret, celles qui ne peuvent être délivrées qu’à la personne concernée et celles qu’on peut obtenir sans restriction. La disponibilité des informations permettra aux citoyens d’accéder plus facilement aux services publics et de mieux connaître leurs droits.
Elle facilitera par ailleurs la tâche aux chercheurs. Cependant, il aurait été judicieux que l’on précisât également l’utilisation des langues nationales dans la promotion du droit d’accès à l’information, afin de toucher efficacement et effectivement toutes les couches de la société. La Commission nationale d’accès à l’information (CNAI) instituée devra jouer un rôle essentiel pour que l’accès à l’information soit une réalité, et surtout que les assujettis acceptent de jouer pleinement le jeu. Mais il faut dire qu’on aurait pu aller vers des exigences plus contraignantes pour les assujettis et renforcer les pouvoirs de la Commission pour plus d’efficacité.
Enfin, que dire du projet de loi sur la réforme de l’OFNAC ?
Concernant le projet de loi sur l’OFNAC, on peut noter de prime abord une sorte de contradiction à l’article 1 : « Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Office national de lutte contre la corruption, en abrégé « OFNAC ». L’OFNAC est rattaché à la présidence de la République. ». Sur le plan symbolique, couper ce lien avec la présidence aurait été un signal fort. Par ailleurs, il y a des avancées significatives dans cette nouvelle loi de l’OFNAC, notamment : la suppression des dispositions relatives à la prérogative de l’OFNAC de procéder à des gardes à vue ; l’exclusion des missions d’audit et de lutte contre la fraude dans les attributions de l’OFNAC ; la systématisation de l’appel à candidature pour la nomination des membres de l’OFNAC ; la libre publication des rapports de l’OFNAC prévue à l’article 12 dernier alinéa qui dispose : « Le rapport d’activités annuel de l’OFNAC est rendu public par tous les moyens appropriés par les soins de son Président. »
Le projet de loi établit un équilibre entre efficacité de la répression et respect des droits des mis en cause, comme le montre très bien l’article 38 : « Si les informations collectées et analysées à l’issue de ses investigations font présumer de l’existence de l’une des infractions visées dans la présente loi, l’Assemblée des membres de l’OFNAC, siégeant en formation plénière, décide de la transmission au procureur de la République compétent d’un rapport accompagné des pièces du dossier. Le procureur qui reçoit un rapport de l’OFNAC, sauf médiation pénale ou complément d’enquête, saisit immédiatement le juge d’instruction ou la juridiction de jugement compétente. Dans tous les cas, les décisions des autorités judiciaires sont, dans le mois de leur prononcé, portées, par le ministère public à la connaissance de l’OFNAC. »
REALISE PAR NANDO CABRAL GOMIS
L’article Projets de lois sur la transparence et lutte contre la corruption : le Pr. Maurice Soudieck Dione alerte sur les zones d’ombre est apparu en premier sur Sud Quotidien.
 Everywhere
Everywhere Albums
Albums ITEM_TYPE_ALBUM_CATEGORY
ITEM_TYPE_ALBUM_CATEGORY ITEM_TYPE_SESNEWS_RSS
ITEM_TYPE_SESNEWS_RSS Members
Members Videos
Videos News
News